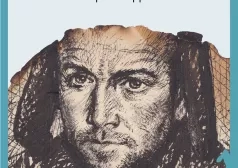Cette image avec un slogan bouleversant est apparue mercredi, peu après l’annonce par le président Poutine d’une « mobilisation partielle ». J’espérais pouvoir en parler le jour même sur le plateau de la RTS, mais l’image n’était pas d’assez bonne résolution, le délai était trop court et il n’y a avait pas assez de temps pour en parler à l’antenne.

Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация
"Два прокурора"

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article
"Deux procureurs"

Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication
"Two prosecutors"






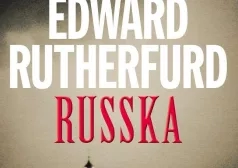


 (c) votrepolice.ch
(c) votrepolice.ch