Breadcrumb
- Home
- L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky
ABONNEZ-VOUS À CE BLOG PAR E-MAIL
L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky
На данный момент записи отсутствуют
A PROPOS DE CE BLOG

Nadia Sikorsky a grandi à Moscou, où elle a obtenu un master de journalisme et un doctorat en histoire à l’Université d’Ètat de Moscou. Après 13 ans au sein de l’Unesco à Paris puis à Genève, et exercé les fonctions de directrice de la communication à la Croix-Verte internationale, fondée par Mikhaïl Gorbatchev, elle développe NashaGazeta.ch, quotidien russophone en ligne.
En 2022, elle s’est trouvée parmi celles et ceux qui, selon la rédaction du Temps, ont « sensiblement contribué au succès de la Suisse romande », parmi les faiseurs d’opinion et leaders économiques, politiques, scientifiques et culturels – le Forum des 100.
ARTICLES RÉCENTS
ABONNEZ-VOUS À CE BLOG PAR E-MAIL
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 100.31

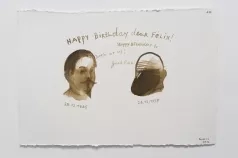



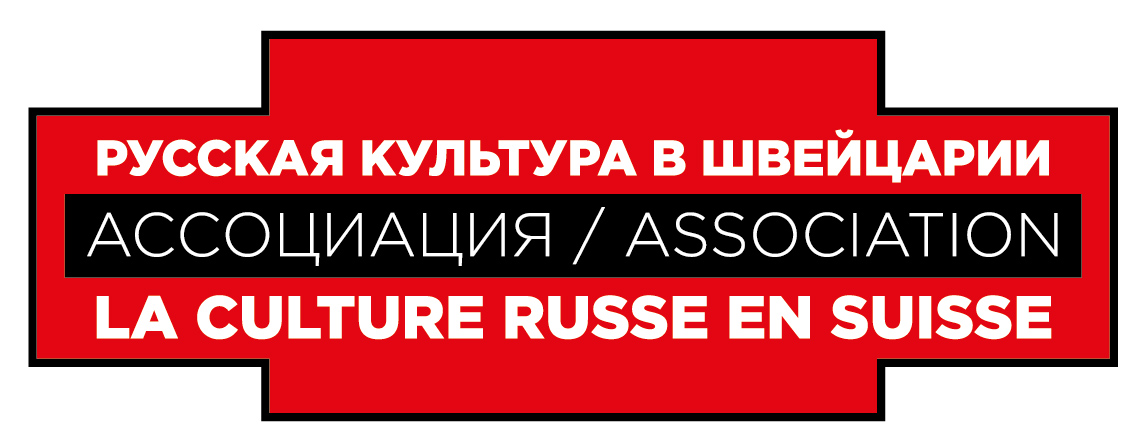







COMMENTAIRES RÉCENTS