 "Macbeth" à l'Opernhaus Zürich (c) N. Sikorsky
"Macbeth" à l'Opernhaus Zürich (c) N. Sikorskyll est difficile d’imaginer une œuvre d’art qui correspondrait plus à notre état d’esprit actuel que le chef d’œuvre de Guiseppe Verdi dans la mise-en-scène de Barrie Kosky à l’Opernhaus Zürich bien qu’elle date de 2016.
En ce moment qui ne se prête pas aux distractions, je me suis tout de même rendue à Zurich, et ceci pour deux raisons. D’abord, parce que je partage la certitude exprimée il y a quelques jours par le maestro Jonathan Nott que la musique soulage. Puis, parce que je voulais voir de mes propres yeux la production qui a été précédée d’un scandale autour de la chanteuse russe Anna Netrebko, je vous en ai déjà parlé.
Je suis heureuse d’avoir surmonté la paresse et que mes craintes n’aient pas été confirmées. Non, je ne me faisais pas de soucis pour les cotés musical et vocal de cette production, mais plutôt pour la scénographie et la vision du metteur-en-scène. L’opéra traverse aujourd’hui une phase quand les plus solides « duos » de compositeurs et auteurs d’œuvres littéraires à base de librettos ont du mal à résister à la fantaisie (phantasmes ?) des metteurs-en-scène, la fantaisie que je trouve parfois privée de sens commun et de bon gout. Je vais donc laisser de côté la musique de Verdi qui est hors concours et ne nécessite pas mes éloges – chaque air, chaque ensemble, chacun des magnifiques chœurs provoquent des frissons, l’extase et des larmes, comme il se doit.
Je vais me concentrer sur ce qui se passe sur scène, pourvue des expériences négatives de « Eugène Onéguine » et « Boris Godunov » revisités per Barrie Kosky à l’Opernhaus Zürich ces dernières années.
Je ne crois pas avoir baissé mes défenses uniquement parce que les Écossais et les Norvégiens placés par William Shakespeare dans le contexte du 11è siècle me sont moins proches et moins chers. Peu importe la raison, j’applaudis cette version de « Macbeth » de tout cœur. Bien que pas au premier coup d’œil.
… Le rideau s’est ouvert pendant l’Ouverture magistrale et a révélé, sur la scène non encombrée par un décor, Macbeth prosterné, couvert par quelque chose ressemblant à des chiffons noirs (le baryton roumain Georges Petean est excellent dans ce rôle). Derrière lui, sous une espèce de lustre-couvercle, un groupe de gens nus, avec des organes sexuels « confondus ». Horrifiée et anticipant la suite, j’ai regardé une amie à côté de moi : « Et voilà, ça commence ! » Mais les chiffons se sont avérés être des plumes noires de corbeaux, dont le symbolisme est évident. Quant aux personnes nues, - pour ceux ayant regardé récemment le « Babi Yar », j’ai d’abord cru à une allusion macabre aux Juifs emmenés dans une chambre à gaz – leur présence étant justifiée par Shakespeare lui-même. De retour à la maison, j’ai pris le texte original sur mon étagère, ainsi que sa traduction en russe, brillante, par Boris Pasternak, et j’ai trouvé ces paroles de Banco étonné :
What are these So wither'd and so wild in their attire, That look not like the inhabitants o' the earth, And yet are on't? Live you? or are you aught That man may question? You seem to understand me, By each at once her chappy finger laying Upon her skinny lips: you should be women, And yet your beards forbid me to interpret That you are so.
Mais bien sûr, ce sont des sorcières, des sorcières qui comme des Parques dans les tragédies grecques, annoncent les horreurs à suivre, en promettant à Macbeth la couronne écossaise ! Sauf que Barri Kosky a remplacé les barbes par d’autres « attributs » masculins qui souvent se substituent aux cerveaux de certains hommes. D’ailleurs, après quelques minutes je ne les remarquai s plus, « camouflés » par un éclairage subtil.
Si seulement Macbeth les avait ignorées, ces sorcières, si seulement il avait remis à sa place sa « lady » - pas moins effrayante en ancienne Ecosse que dans la ville de Mtsensk, plus proche de nous grâce aux génies de Nikolaï Leskov et Dmitri Shostakovich. Mais rares sont les hommes dont l’orgueil résiste à une femme manipulatrice qui sait parfaitement où appuyer pour atteindre son but – l’endroit est toujours le même, bien banal. (La soprano russe Veronika Dzhioeva est d’ailleurs merveilleuse dans le rôle de Lady Macbeth !)
Si seulement il écoutait le courageux Banco (magnifiquement interprété par le basse ukrainien Vitaly Kovalev qui j’ai déjà admiré dans les rôles de Général Grèmin et Pimen sur la scène genevoise) ! Car Banco lui dit on ne peut pas plus clairement :
The instruments of darkness tell us truths, Win us with honest trifles, to betray's In deepest consequence.
Mais Macbeth est sourd à la voix de la raison. Et ainsi il se met sur le chemin du pouvoir, un chemin pavé par les trahisons et arrosé du sang, accompagné par la foule, toujours avide des spectacles gratuits. Une fois ce chemin emprunté, l’homme ne peut plus s’arrêter : chaque crime dont il s’en tire sans châtiment le pousse vers le suivant, en ignorant la mort et le malheur qu’il emmène avec lui. Le cataplasme saisi la gorge quand on entend le chœur, qui, au nom de ceux qui ont perdu leurs maris et leurs enfants, appelle aux cieux en réclamant la vengeance… Comment est-ce possible que malgré tous les exemples historiques que nous connaissons, on trouve toujours ceux qui embarquent sur ce chemin sans issue ?!
La scénographie minimaliste à l’extrême de l’allemand Klaus Grünberg – un tunnel noir sans fin éclairé par des petits lumières blanches – ne nécessite aucun effet supplémentaire. Elle ne fait qu’accentuer la puissance de la musique et du texte, les plaçant au premier plan. Et annonçant dès le début le final bien connu : la fin solitaire et sans gloire d’un tyran obsédé par le pouvoir qui a perdu la raison, dont aucune lumière n’attend au bout du tunnel noir et dont la mort ne sera pas déplorée, même par la foule… Cela peut paraitre étonnant mais dans les scènes finales du spectacle de Macbeth, qui, en l’absence d’autres interlocuteurs essaye de converser avec des corbeaux, m’avait rappelé le Dictateur immortalisé par Charlie Chaplin – cette scène où il tourne le globe sur le doigt, fou à lier.
Y-a-t-il une lumière d’espoir pour nous les spectateurs ? Peut-on le soupçonner dans le T-shirt blanc (le drap mortuaire ?) de Macbeth, couvert des plumes noires comme des cendres ? Ou dans le fait qu’à la fin du spectacle, Veronika Dzhioeva et Vitaly Kovalev se tiennent par la main, ovationnées par le public ? Oh, que j’aimerais y croire ! Quant au « deepest consequence », nous allons encore en déguster.
What's more to do, Which would be planted newly with the time, As calling home our exiled friends abroad That fled the snares of watchful tyranny; Producing forth the cruel ministers Of this dead butcher and his fiend-like queen, Who, as 'tis thought, by self and violent hands Took off her life; this, and what needful else That calls upon us, by the grace of Grace< >


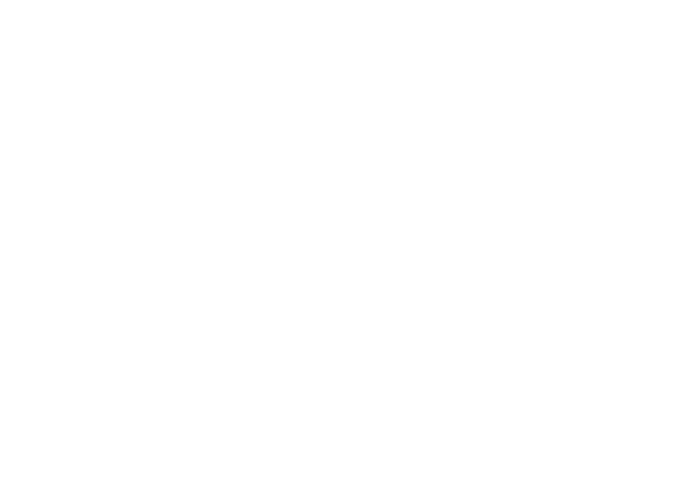
 Photo de I. Cernova Burger
Photo de I. Cernova Burger
 "Poutine n'est pas la Russie". J'ai pris cette photo lors une manifestation à la place de Neuve, à Genève, samedi dernier
"Poutine n'est pas la Russie". J'ai pris cette photo lors une manifestation à la place de Neuve, à Genève, samedi dernier Grand Théâtre de Genève (c) GTG
Grand Théâtre de Genève (c) GTG
 L'Opernhaus de Zurich
L'Opernhaus de Zurich

 Il y a quelques jours, en répondant à la question d’une journaliste de La Tribune de Genève sur la situation en Ukraine, j’ai dit que j’étais convaincue que personne ne veuille la guerre. Que les Russes et les Ukrainiens sont les otages de politiciens motivés par leurs egos hors normes. Que ce qui se passe, est un échec de la diplomatie mondiale.
Aujourd’hui, en répondant à la même question, j’aurais apporté une nuance en remplaçant « personne » par « la plupart ». Car il se trouve qu’il y a des gens qui la veulent, cette guerre.
Ces derniers jours je suis accrochée à plusieurs écrans à la fois, je lis des nouvelles et des opinions exprimées dans les réseaux sociaux, je compare, j’analyse, j’essaye de comprendre. Ce qui n’est pas facile.
J’essaye de me mettre à la place de M. Poutine – oui, il faut beaucoup d’imagination ! J’avoue que, quand lundi dernier, il a annoncé la reconnaissance de deux républiques auto-proclamées, j’ai été outrée mais aussi quelque part soulagée en me disant que tout allait s’arrêter là, comme pendant le conflit avec la Géorgie. Beaucoup de gens ont partagé mon avis. Surtout qu’il n’arrêtait pas de dire qu’il n’avait pas l’intention d’envahir l’Ukraine.
Pourquoi alors le faire deux jours avant la rencontre MM Lavrov-Blinken à Genève et trois jours avant sa propre rencontre avec M. Marcon ? M. Poutine a commencé cette offensive sous le prétexte de la défense des russophones en Ukraine. Alors que avec tous les jokers qu’il avait dans la main, il aurait pu négocier pratiquement tout, y compris peut-être la restauration du russe comme deuxième langue nationale en Ukraine, un de principaux points de discorde. Il aurait pu prendre sa revanche sur les humiliations présumées subies par les russophones en Ukraine et sortir avec la tête haute. Il aurait même pu faire un geste et inviter les russophones qui ne sont pas heureux en Ukraine à émigrer en Russie – légalement, en plein jour, avec l’accord du gouvernement ukrainien : après tout, Brejnev et Carter ont réussi à régler ainsi le problème d’émigration juive dans les années 1970. Tout cela se discute, c’est à la régularisation de ses questions que servent les négociations diplomatiques, précisément !
Je ne comprends pas pourquoi le président Poutine avait besoin de franchir cette dernière frontière qui devait à tout prix rester infranchissable ! Aurait-il perdu la tête ? Assistons-nous à une démonstration flagrante de ce qui arrive quand absolute power corrupts absolutely ? Ou s’agit-t-il d’une fine stratégie incompréhensible aux mortels ?
En commençant cette guerre - ou « l’opération militaire spéciale » comme les médias russes sont obligés de l’appeler sous peine de grosses amendes – il l’a fait au nom du peuple russe. Il a ainsi fait le peuple russe complice de son crime. Le peuple russe, est-il prêt à assumer cette responsabilité ? A ma grande surprise et à mon plus grand désespoir, je constate que partiellement – oui.
L’organe de contrôle russe a obligé tous les médias accrédités en Russie à n’utiliser, pour couvrir cette guerre, que les sources officielles russes. Comme vous pouvez l’imaginer, ces sources sont peu crédibles aux yeux de beaucoup de mes collègues sur place. Mais ça marche ! Les millions de Russes qui habitent loin des grandes villes, qui n’utilisent pas l’internet et qui ne regardent que la TV d’état, ont leur cerveaux complétement lavés. Non, je ne dis pas qu’il n’y a pas de propagandes en Ukraine, ou aux États-Unis ou en Europe, mais je parle de mon pays, le pays qui a déclenché la guerre. Un sociologue russe de renom dit que les fake news influencent surtout les habitants des provinces, moins éduqués. Alors comment peut-on expliquer que même parmi mes lecteurs en Suisse, même parmi mes amis sur Facebook, certains justifient cette guerre qui ne peut pas être justifiée ?! Grâce à Dieu ou son ad intérim, ils ne sont pas nombreux, mais il n’y en a.
Je regarde les chaînes d’état russes – en petites quantités, pour ne pas perdre la tête. Je regarde aussi BBC, CNN, RTS, BFM TV… mais surtout je parle avec mes amis russes et ukrainiens, qui sont pour moi les plus fiables des sources. Et ce que j’entends me donne des frissons… L’Ukraine affiche le nombre de ses morts, la Russie pas. Mais on parle déjà de milliers. De milliers de jeunes hommes en bonne santé qui ont à peine commencé leurs vies et sont mort en quelques jours – et pour quoi ?! Moi-même mère de deux garçons qui représentent pour moi le monde entier, je pleure aujourd’hui avec toutes ces mères, toutes sans exception, car aucune n’a choisi un tel sort pour son fils.
J’ai eu la chance d’être née dans le milieu artistique de Moscou et d’appartenir, par le fait de ma naissance, à l’intelligentsia russe qui a toujours joué un rôle très particulier dans mon pays. Certains appellent l’intelligentsia le maillon faible, la 5ème colonne. On me dit parfois que « mon cercle » ne représente que 1 % de la population. Peut-être, mais c’est ce pourcent qui lance les idées, qui forme l’opinion publique. Et oh comme je suis fière que ce soit les gens de « mon cercle » qui se sont montrés les plus actifs et les plus courageux ces derniers jours : les acteurs signent des pétitions ; les cinéastes tournent des clips ; les directeurs des théâtres, même les plus proches du pouvoir, se sont unis ; les médecins, les scientifiques, les écrivains, les journalistes, les musiciens ; les spécialistes russes de Shakespeare ont signé une lettre ouverte commune avec leur collègues ukrainiens… Beaucoup lisent et publient des poèmes, l’ultime remède des Russes dans les pires moments de l’histoire… Tous ces gens qui sont contre la guerre, qui aujourd’hui meurent de honte, qui désespèrent, ils sont aujourd’hui les otages du Système, pas ses complices. Les complices sont ceux qui soutiennent le pouvoir ou qui gardent le silence.
Il y a quelques jours, en répondant à la question d’une journaliste de La Tribune de Genève sur la situation en Ukraine, j’ai dit que j’étais convaincue que personne ne veuille la guerre. Que les Russes et les Ukrainiens sont les otages de politiciens motivés par leurs egos hors normes. Que ce qui se passe, est un échec de la diplomatie mondiale.
Aujourd’hui, en répondant à la même question, j’aurais apporté une nuance en remplaçant « personne » par « la plupart ». Car il se trouve qu’il y a des gens qui la veulent, cette guerre.
Ces derniers jours je suis accrochée à plusieurs écrans à la fois, je lis des nouvelles et des opinions exprimées dans les réseaux sociaux, je compare, j’analyse, j’essaye de comprendre. Ce qui n’est pas facile.
J’essaye de me mettre à la place de M. Poutine – oui, il faut beaucoup d’imagination ! J’avoue que, quand lundi dernier, il a annoncé la reconnaissance de deux républiques auto-proclamées, j’ai été outrée mais aussi quelque part soulagée en me disant que tout allait s’arrêter là, comme pendant le conflit avec la Géorgie. Beaucoup de gens ont partagé mon avis. Surtout qu’il n’arrêtait pas de dire qu’il n’avait pas l’intention d’envahir l’Ukraine.
Pourquoi alors le faire deux jours avant la rencontre MM Lavrov-Blinken à Genève et trois jours avant sa propre rencontre avec M. Marcon ? M. Poutine a commencé cette offensive sous le prétexte de la défense des russophones en Ukraine. Alors que avec tous les jokers qu’il avait dans la main, il aurait pu négocier pratiquement tout, y compris peut-être la restauration du russe comme deuxième langue nationale en Ukraine, un de principaux points de discorde. Il aurait pu prendre sa revanche sur les humiliations présumées subies par les russophones en Ukraine et sortir avec la tête haute. Il aurait même pu faire un geste et inviter les russophones qui ne sont pas heureux en Ukraine à émigrer en Russie – légalement, en plein jour, avec l’accord du gouvernement ukrainien : après tout, Brejnev et Carter ont réussi à régler ainsi le problème d’émigration juive dans les années 1970. Tout cela se discute, c’est à la régularisation de ses questions que servent les négociations diplomatiques, précisément !
Je ne comprends pas pourquoi le président Poutine avait besoin de franchir cette dernière frontière qui devait à tout prix rester infranchissable ! Aurait-il perdu la tête ? Assistons-nous à une démonstration flagrante de ce qui arrive quand absolute power corrupts absolutely ? Ou s’agit-t-il d’une fine stratégie incompréhensible aux mortels ?
En commençant cette guerre - ou « l’opération militaire spéciale » comme les médias russes sont obligés de l’appeler sous peine de grosses amendes – il l’a fait au nom du peuple russe. Il a ainsi fait le peuple russe complice de son crime. Le peuple russe, est-il prêt à assumer cette responsabilité ? A ma grande surprise et à mon plus grand désespoir, je constate que partiellement – oui.
L’organe de contrôle russe a obligé tous les médias accrédités en Russie à n’utiliser, pour couvrir cette guerre, que les sources officielles russes. Comme vous pouvez l’imaginer, ces sources sont peu crédibles aux yeux de beaucoup de mes collègues sur place. Mais ça marche ! Les millions de Russes qui habitent loin des grandes villes, qui n’utilisent pas l’internet et qui ne regardent que la TV d’état, ont leur cerveaux complétement lavés. Non, je ne dis pas qu’il n’y a pas de propagandes en Ukraine, ou aux États-Unis ou en Europe, mais je parle de mon pays, le pays qui a déclenché la guerre. Un sociologue russe de renom dit que les fake news influencent surtout les habitants des provinces, moins éduqués. Alors comment peut-on expliquer que même parmi mes lecteurs en Suisse, même parmi mes amis sur Facebook, certains justifient cette guerre qui ne peut pas être justifiée ?! Grâce à Dieu ou son ad intérim, ils ne sont pas nombreux, mais il n’y en a.
Je regarde les chaînes d’état russes – en petites quantités, pour ne pas perdre la tête. Je regarde aussi BBC, CNN, RTS, BFM TV… mais surtout je parle avec mes amis russes et ukrainiens, qui sont pour moi les plus fiables des sources. Et ce que j’entends me donne des frissons… L’Ukraine affiche le nombre de ses morts, la Russie pas. Mais on parle déjà de milliers. De milliers de jeunes hommes en bonne santé qui ont à peine commencé leurs vies et sont mort en quelques jours – et pour quoi ?! Moi-même mère de deux garçons qui représentent pour moi le monde entier, je pleure aujourd’hui avec toutes ces mères, toutes sans exception, car aucune n’a choisi un tel sort pour son fils.
J’ai eu la chance d’être née dans le milieu artistique de Moscou et d’appartenir, par le fait de ma naissance, à l’intelligentsia russe qui a toujours joué un rôle très particulier dans mon pays. Certains appellent l’intelligentsia le maillon faible, la 5ème colonne. On me dit parfois que « mon cercle » ne représente que 1 % de la population. Peut-être, mais c’est ce pourcent qui lance les idées, qui forme l’opinion publique. Et oh comme je suis fière que ce soit les gens de « mon cercle » qui se sont montrés les plus actifs et les plus courageux ces derniers jours : les acteurs signent des pétitions ; les cinéastes tournent des clips ; les directeurs des théâtres, même les plus proches du pouvoir, se sont unis ; les médecins, les scientifiques, les écrivains, les journalistes, les musiciens ; les spécialistes russes de Shakespeare ont signé une lettre ouverte commune avec leur collègues ukrainiens… Beaucoup lisent et publient des poèmes, l’ultime remède des Russes dans les pires moments de l’histoire… Tous ces gens qui sont contre la guerre, qui aujourd’hui meurent de honte, qui désespèrent, ils sont aujourd’hui les otages du Système, pas ses complices. Les complices sont ceux qui soutiennent le pouvoir ou qui gardent le silence.
 Genève, samedi 26 février 2022
Genève, samedi 26 février 2022






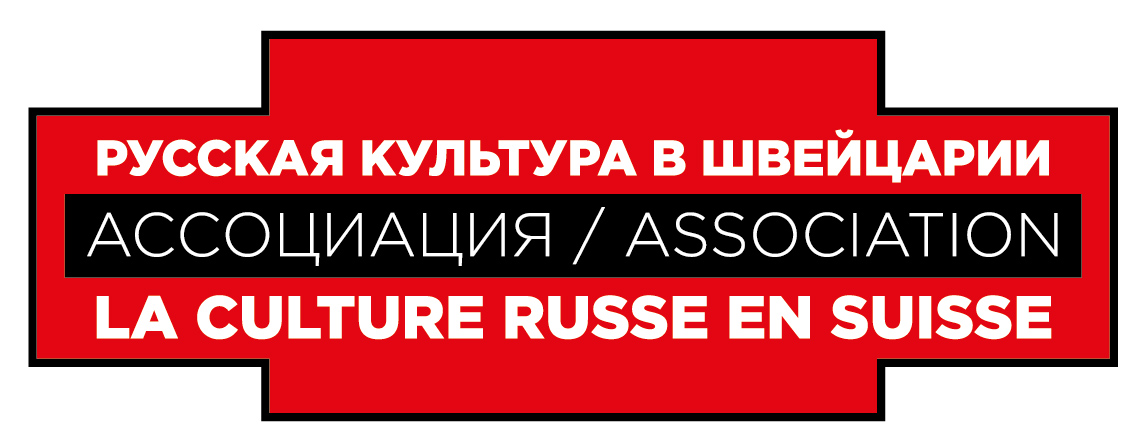







COMMENTAIRES RÉCENTS