
Parmi les trésors d’internet, on trouve cette photo prise à Moscou en 1964. Vous y reconnaîtrez facilement Marlène Dietrich, bien sûr. Mais qui donc est cet homme à qui la grande dame, agenouillée, baise la main ? Il s’agit de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski (1892-1968), nominé trois fois pour le prix Nobel de littérature et très peu connu en Occident – car très peu traduit. Après être tombée par hasard sur une traduction anglaise de son récit Télégramme (1946), Marlène Dietrich en fut bouleversée à tel point qu’elle se mit en tête de rencontrer son auteur.
Constantin Paoustovski est « un autre romancier soviétique, aussi doué, aussi original, [dont] les historiens de la littérature n’ont pas pris la mesure, quand ils ne l’ignorent pas purement et simplement. La gigantesque Histoire de la littérature russe de Fayard, ouvrage collectif, rédigée en partie par des Russes, dont les trois volumes dédiés au XXe siècle remplissent trois mille pages, ne lui consacre ni un chapitre ni même une page entière », écrit Dominique Fernandez de l’Académie française dans Le roman soviétique, un continent à découvrir, une étude de plus de cinq cents pages parue chez Grasset.
« Un livre sur le roman soviétique, maintenant ? Précisément maintenant : comme le disait Romain Rolland pendant la Grande Guerre, ce n’est pas parce que les Allemands l’ont voulue que nous allons renier Goethe », lisons-nous sur la couverture. La question est légitime, mais l’auteur assume la réponse. Il est même content que ce livre qu’il « porte en lui » depuis soixante ans paraisse maintenant, justement, bien que ce ne soit qu’une coïncidence. Il est content car « comme avant il ne fallait pas confondre tous les Russes avec Staline, aujourd’hui il ne faut pas tous les confondre avec Poutine », dit-il, horrifié par la guerre en Ukraine mais aussi par les tentatives d’annihiler la culture russe, dont il reste amoureux – son Dictionnaire amoureux de la Russie (Plon, 2004) est un témoignage éloquent de cet attachement.
Adolescent, il a été introduit dans « une maison russe » parisienne du prince Igor Demidov et de son fils, appelé également Igor. À l’âge de quinze ans, Dominique Fernandez a lu Guerre et Paix de Tolstoï « en trois jours et trois nuits ». Dès le début de sa carrière de critique littéraire, en 1955, il a commencé à écrire sur les auteurs russes – Ilya Ehrenbourg (à qui nous devons le terme « Dégel » pour désigner une période de libéralisation de la littérature en URSS), Vera Panova, Constantin Simonov, Sergueï Antonov… Il est l’auteur de Les Enfants de Gogol (Grasset, 1971), Eisenstein (Grasset, 1975), Place Rouge (Grasset, 2008), Avec Tolstoï (Grasset, 2010)… Tout cela sans pour autant se considérer comme un slaviste.
Dans une interview d’une heure que Dominique Fernandez m’a accordée, ce jeune homme de quatre-vingt-treize ans qui a lu sept cents (!) romans russes (« tout ce qui a été traduit en français »), n’a pas oublié une seule date, n’a pas hésité une seule fois sur un nom ou sur un titre. Son esprit est aussi clair que le sont ses propos et le but déclaré de son ouvrage « consacré aux romanciers russes qui ont assumé l’appellation de soviétiques ». « Doit-on pour autant les ignorer, et, si on ne les ignore pas, les accabler de mépris parce qu’ils sont restés en Russie, ont publié librement et fait carrière en URSS, et même pour certains, reçu des prix Staline et occupé des postes officiels dans la haute administration des biens culturels ? Est-il vrai qu’ils étaient tous vendus au pouvoir ? Que certains n’avaient pas une foi sincère dans le communisme et dans les conquêtes de la Révolution ? Que d’autres n’avaient pas trouvé le talent de déjouer la censure ? L’allégorie, la science-fiction, l’humour, si souvent présents dans les romans de cette époque, n’ont-ils pas été pour ceux qui les maniaient, avec une virtuosité inconnue en Occident, des moyens de se désolidariser des succès du régime qu’ils feignaient d’encenser ? »
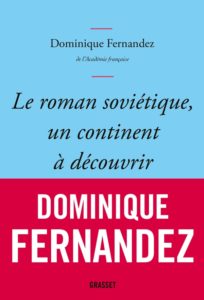
Toutes ces questions, Dominique Fernandez les applique, cas par cas, à plus de quarante auteurs, nous racontant leurs vies et leurs œuvres, leurs illusions et leurs désillusions. Sans porter de jugement, il explique aussi bien le contexte historique que les circonstances personnelles de chacun d’eux, en les rendant plus humains et plus proches de nous. « Virgile a écrit l’Énéide sur commande pour glorifier l’empereur Auguste, mais on oublie tout cela », m’a-t-il dit, défendant le droit du créateur de faire partie de son époque et de s’en échapper.
Un livre pour tous ceux qui s’intéressent à la littérature et à l’histoire russes du XXe siècle, avec tous leurs paradoxes.

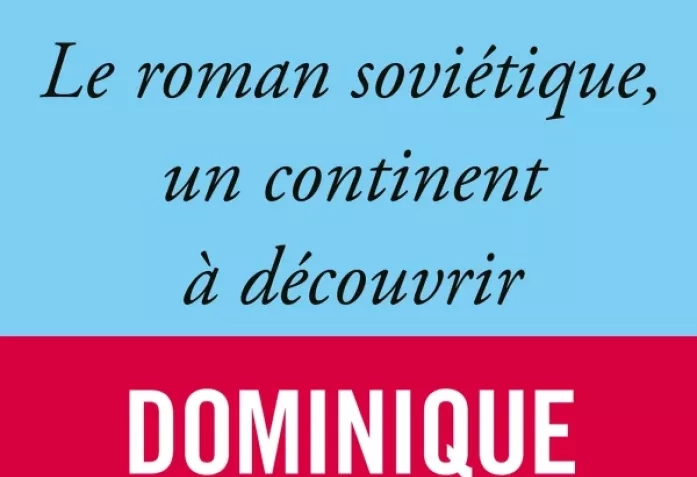





 © Debby Hudson on Unsplash
© Debby Hudson on Unsplash
 Ilia Répine. Le duel d'Onéguine et Lenski, 1899. © Musée Alexandre Pouchkine, Russie)
Ilia Répine. Le duel d'Onéguine et Lenski, 1899. © Musée Alexandre Pouchkine, Russie)




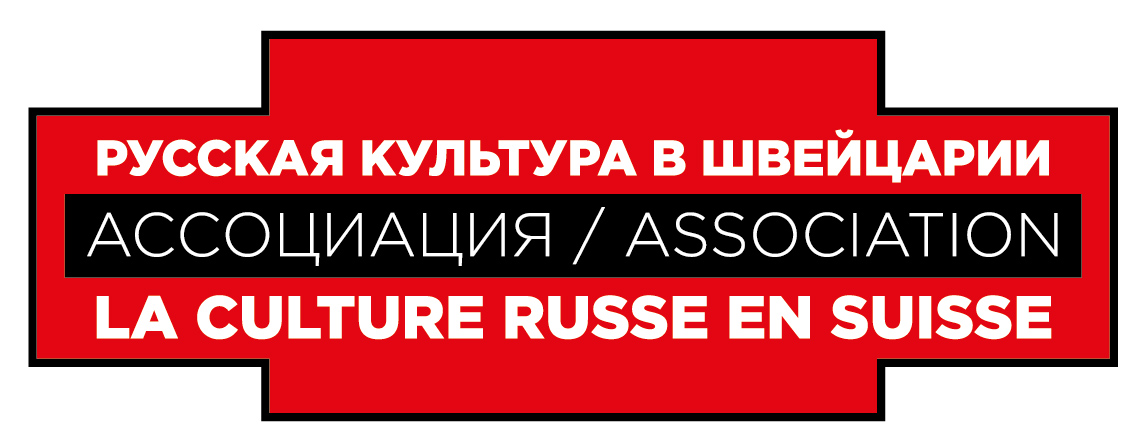






COMMENTAIRES RÉCENTS